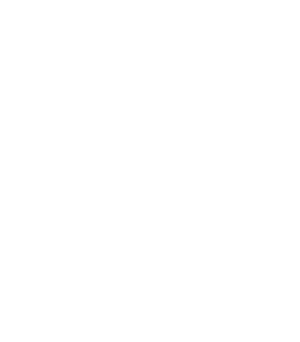Grand entretien avec…
Rob Hopkins : « Imaginons ensemble l’avenir des territoires »
À l’occasion de “l’Appel du 18 juin”, dédié à la Transition écologique, Rob Hopkins, fondateur du mouvement mondial des villes en Transition et protagoniste du film Demain, a fait étape à l’auditorium du pôle culturel Chabran, à Draguignan l’an passé.
Lors d’une conférence inspirante, il a partagé son expérience et inspiré les acteurs locaux et les citoyens du territoire.
Propos recueillis lors de cette rencontre, animée et co-organisée avec le magazine “Sans Transition !”
Pourquoi est-il important selon vous de s’engager dans une démarche de transition ?
Rob Hopkins :
En 2070, trois milliards d’individus seront dans des zones où la vie humaine sera devenue impossible en raison de la chaleur.
Alors le moment est venu de choisir notre camp. Soit vous dites, c’est trop difficile on n’y arrivera pas, ou alors, soit vous dites voilà une opportunité à saisir.
On va réimaginer le monde, créer une nouvelle société. On se lance et ça va être exaltant !
D’où vous vient cette volonté de transformer notre modèle économique, à l’échelle locale, pour faire face au dérèglement climatique ?
R.H. :
J’ai enseigné la permaculture pendant de nombreuses années.
Le modèle de la forêt est un très bel outil pour décrire l’économie locale, en s’intéressant à la façon dont elle s’occupe de la gestion de l’eau.
La pluie tombe du ciel, les feuilles recueillent la pluie. Ça descend le long des branches, du tronc et ce flux arrive dans les racines.
L’eau circule partout où la forêt en a besoin et reste en place.
Imaginez une forêt conçue par un économiste néolibéral. L’eau serait récupérée dans une méga-bassine et les arbres ne pourraient même pas la recueillir.
À la place de l’eau dans la forêt, regardons l’argent dans une ville, on se rend compte que plus l’argent circule, plus il crée de richesses.
C’est bien cela la logique de l’économie locale !
Comment transformer les villes, les entreprises et les territoires pour les rendre plus résilients ?
R.H. :
Je suis de plus en plus convaincu que la voie à suivre, c’est celle de la conception et de la contribution citoyenne, en association étroite avec les municipalités, les collectivités locales, territoriales, mais aussi avec les entreprises implantées localement.
À mon avis, il est absolument nécessaire de bâtir une infrastructure de l’imagination.
Lorsqu’une ville ou une région facilite l’imagination de ses citoyens, puis la convoque, le champ des possibles s’ouvre.
Cela fait également appel à une nouvelle manière de penser la démocratie, avec des assemblées de citoyens, la mise en place de budgets participatifs, etc.
Dans la ville de Bologne en Italie, la municipalité a mis en place un bureau civique de l’imagination.
On fait venir les citoyens et on leur demande s’ils ont des idées pour leur ville.
Ils sont particulièrement bien placés pour dire ce dont ils ont besoin et ce qu’ils désirent.
Au bout du compte, 500 pactes ont été signés avec la municipalité, en faveur du progrès dans la ville.
Quelles solutions s’offrent à l’échelle locale pour accélérer la transition ?
R. H. :
D’abord, il faut créer une économie enracinée.
Et pour arriver à financer cette économie au niveau local, il faut s’appuyer sur d’autres structures de soutien financier.
Tout cela avec un sens de l’initiative.
À Liège, il s’est produit quelque chose de révolutionnaire et cela a été lancé par une demi-douzaine de personnes.
Ils ont décidé de lever de l’argent auprès des citoyens.
En quelques années, ils ont récolté 5 millions d’euros et ont pu créer 27 coopératives alimentaires pour regagner leur souveraineté alimentaire.
Mais l’ingéniosité et les efforts des citoyens ne suffisent pas.
Il faut de l’accompagnement, notamment de la part des municipalités, en levant par exemple les obstacles réglementaires.
Cela a été le cas à Mouans-Sartoux, où il y a eu une révolution alimentaire particulièrement inspirante.
La municipalité a mis à leur disposition des terrains, a levé les obstacles administratifs et a fourni des moyens pour sensibiliser les agents de la ville et les habitants.
Je pense également que l’écologie ne va pas sans la lutte contre les inégalités sociales.
Pour cela, il faut inscrire toute action environnementale par le prisme de la justice sociale, pour que les défavorisés puissent être impliqués dans ce projet de territoire.
👉 Plus d’infos : retrouvez l’intégralité de la table ronde avec Rob Hopkins ici !