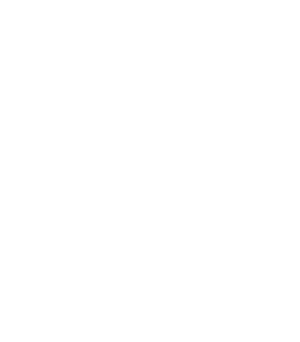Nouveaux regards sur le vivant
À l’occasion du colloque « Nouveaux regards sur le vivant », organisé à l’initiative de Dracénie Provence Verdon agglomération le 17 janvier dernier, à l’antenne de l’université de droit de Draguignan, le philosophe Baptiste Morizot a échangé avec des juristes, sociologue, géographe et historien, sur l’intérêt de renforcer les droits des non-humains. Cet échange s’est poursuivi en soirée lors d’une conférence intitulée « Rendre l’eau à la terre » à la salle Chabran de Draguignan, avec l’auteur de Manière d’être vivant.
Les idées ont fusé entre juristes lors du colloque « Nouveaux regards sur le vivant », le 17 janvier dernier, sous l’œil attentif du philosophe dracénois Baptiste Morizot, qui a également participé aux débats, devant une centaine d’étudiants de l’université de droit de Draguignan. Tous se sont accordés sur le fait qu’il faut faire évoluer le droit des non-humains, des vivants autrement dit. Personnalité juridique d’une rivière pour les uns, entité juridique d’une forêt pour les autres ou plus simplement évolution de l’actuel droit à l’environnement, les professionnels ont pu débattre sur ce sujet particulièrement d’actualité et dont l’objectif est de renforcer le droit du vivant.
Plaidoyer pour des biens communs
« Lorsque l’on préserve le vivant, ce sont également les humains que l’on protège. Il y a longtemps que le droit aurait dû évoluer vers davantage de droits pour le vivant, à nous de développer de nouveaux concepts comme l’entité juridique pour les non-humains avec les rivières ou les forêts »,
a souligné Sylvie Schmitt, maître de conférences à l’université de Toulon lors de la table-ronde d’ouverture.
Pour Laurence Gay, directrice de recherche au CNRS à l’université d’Aix-Marseille :
« On constate l’échec du droit de l’environnement. Il y a certes quelques résultats mais ils ne sont pas à la hauteur. Nous devons nous inspirer des nombreuses initiatives (260 à l’échelle mondiale), comme en Espagne, Bolivie ou en Équateur, qui expérimentent le fait de donner davantage de droits à la nature. »
Propos auxquels a réagi Victor David, chargé de recherches en droit à l’IRD de Marseille :
« Il est possible de penser autrement la nature que comme objet de droit. En Nouvelle-Calédonie, on parle même d’entité naturelle juridique. »
Pour Alexandre Zabalza, professeur en philosophie du droit à l’université de Bordeaux :
« Il convient plutôt de s’appuyer sur la notion de bien commun, pour renforcer les droits du vivant. »
Citant l’exemple de la vallée du Ciron, Alexandre Zabalza a mis en exergue cette rivière singulière située à 60 km de Bordeaux, qui se jette dans la Garonne. Là-bas, le Ciron, riche en biodiversité, est entouré de l’une des plus vieilles forêts d’Europe, fragilisée actuellement par le projet de LGV à venir. Le chercheur plaide pour que la communauté locale des humains qui habitent à proximité puisse devenir une personnalité juridique, pour pouvoir préserver ce bien commun qu’est selon lui la vallée du Ciron.
Rendre l’eau à la Terre
Ce colloque passionnant s’est poursuivi par la conférence grand public de Baptiste Morizot, intitulée « Rendre l’eau à la Terre », en soirée, rappelant que :
« La santé des écosystèmes est fondamentale pour la santé des sociétés humaines. »
Durant plus d’une heure, dans une salle Chabran comble, le philosophe a invité le public nombreux à repenser notre relation au vivant, en termes de coopération et de réciprocité aux écosystèmes.
« Il n’y aurait pas d’agriculture sans l’intervention des non-humains, dont les pollinisateurs par exemple. Nous avons besoin d’une alliance avec eux pour traverser les crises écologiques contemporaines »,
a-t-il poursuivi.
À travers l’exemple du castor, dont les populations se sont effondrées en France, il a pu illustrer la manière dont les territoires et les citoyens peuvent régénérer le vivant et les milieux, en s’inspirant du travail de ce rongeur semi-aquatique pour réhydrater la terre.
« Il faut passer de l’ère du drainage à celle du freinage, […], nous devons préserver les rivières, les forêts, les castors entre autres car ce sont eux qui peuvent nous aider à régénérer les écosystèmes »,
a-t-il expliqué.
Parlement du vivant
Cette journée a également été l’occasion pour le territoire de lancer son « Parlement du vivant », à destination des jeunes dracéniens de 16 à 25 ans.
Objectif : les inviter à participer à une expérimentation locale de gouvernance participative sur la Nartubie, visant à :
« inclure la biodiversité dans les décisions publiques. Cette initiative ambitionne de préciser, avec ces jeunes citoyens, les politiques locales, pour qu’elles tiennent davantage compte des besoins des écosystèmes et des espèces qui y vivent »,
précise la collectivité.
Cette belle dynamique citoyenne vise à donner une voix aux non-humains du territoire et à inscrire ainsi le vivant dans l’ADN dracéniens !
👉 Plus d’infos : https://www.dracenie.com/le-parlement-du-vivant.html